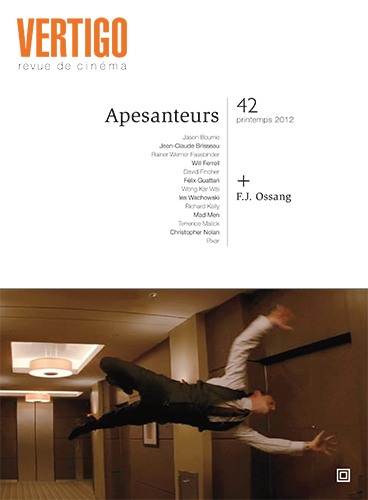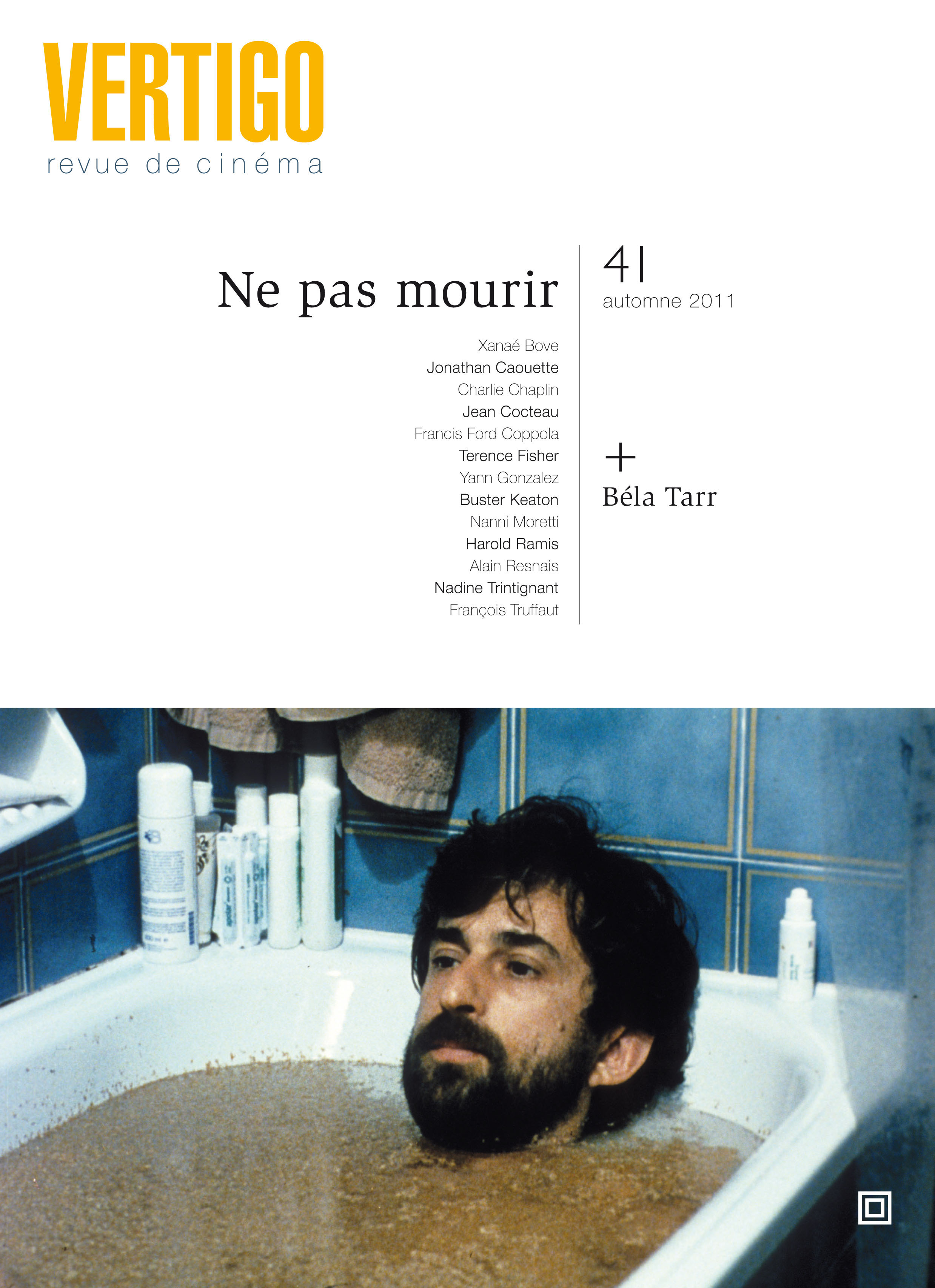« Un glissement a lieu. Il se produit, il est à l’œuvre [...] Comme toujours, forcément, nous en sommes à la fois les auteurs et témoins [...] Il est trop tôt pour savoir ou pour sentir s’il s’agit d’une rupture ou d’une évolution, si le mode est celui du déplacement ou de la cassure, si le cheminement est réversible ou absolument orienté. [...] En fin de compte, tout ce que nous avons nommé « matière », « vie », aussi bien que « nature », « dieu », « histoire », « homme » tombe de la même chute. La « mort de Dieu » est très précisément la mort de toutes ces substances-sujets. Comme la première, ces morts sont très longues, interminables pour notre perception et même pour notre imagination. »
(Jean-Luc Nancy)
S’il nous faut désormais compter avec l’épuisement des systèmes – de représentations, de sens, de valeur, de croyance – issus de la tradition et des récits de la modernité, avec le déclin des constructions sociales, politiques, symboliques et autres qui en assuraient l’effectivité, si, en un mot, la situation historique qui nous échoit se trouve placée, pour une large part, sous le signe de la « fin », il n’est en revanche pas certain que nous soyons en mesure d’identifier de quelles façons une telle implosion affecte nos existences. Sûrement faut-il en trouver la raison dans l’étendue et l’atomisation des effets à travers lesquels « ces morts interminables » adviennent ; et peut-être plus encore, dans le fait qu’un tel processus se déploie sur le mode d’une transition indéfinie, dans les ralentis et les accélérés d’un mouvement où se surimpose à la survivance de ce qui a été, l’indétermination de ce qui vient ; à la persistance des schèmes de représentation qui soutenaient champs d’expérience et horizons d’attente les nouveaux paradigmes générés par l’expansion illimitée du capitalisme. Sans doute aussi la multiplication croissante des phénomènes « à haute teneur catastrophique », témoignant d’un épuisement objectif (des ressources naturelles, des espèces…), ou signalant l’atteinte d’une limite systémique (crises financières, dépérissement de l’État, phase dite « terminale » du capitalisme), complique-t-elle, en exacerbant le sentiment ou le constat de l’imminence de la fin, la perception de ce qui nous arrive.
À considérer ces quelques données, il n’est guère surprenant que le cinéma se soit emparé ces dernières années des phénomènes de décomposition sociale, politique, symbolique ou culturelle qui marquent de part en part le présent.
Entre l’immense désarroi du vieux shérif de No Country for Old Men qui, mesurant jusqu’au bout son impuissance face aux nouvelles formes de violence auxquelles il est désormais confronté, finit par démissionner et l’adolescent de Paranoid Park qui traverse, dans une sorte de désorientation hallucinée, l’anomie d’une réalité où tout semble s’équivaloir ; entre l’étrange détachement qu’affiche, face au désastre, le personnage des Derniers jours du monde et les situations extrêmes auxquelles se risquent les personnages de Crash pour tenter de retrouver l’intensité d’une extase dont le monde ne leur offre plus l’occasion, on pourrait ébaucher la carte des signes et symptômes, bouleversements et étrangetés, aventures, libérations et angoisses que n’en finit pas de produire le glissement historique évoqué par Nancy. Un état des lieux auquel contribueraient sans nul doute les derniers films de Moretti et Lars Von Trier. Le suspens inouï que provoque le désengagement du vieux cardinal Melville dans Habemus Papam ne nous livre pas seulement une image saisissante de l’effritement dont témoignent aujourd’hui les institutions politiques traditionnelles, mais également la tension que crée pour nous l’imminence d’un tel effondrement. La dramaturgie qu’installent l’attente du conclave, les milliers de regards suspendus à l’apparition du nouveau Pape élu et l’impossibilité pour celui-ci – mais aussi bien pour quelque cardinal que ce soit – de pouvoir prétendre en endosser la charge, n’est-elle pas aussi celle qui confronte notre désir collectif de continuité historique à l’obsolescence des formes censées en être les garantes ?
Et de façon équivalente, la mélancolie du personnage de Lars Von Trier, qui la voue à n’envisager la réalité que sous le versant de sa finitude absolue, et finit par acquérir les dimensions d’un événement phénoménologique, puis cosmogonique, ne figure-t-elle pas, dans sa dimension tragique, le désœuvrement ou la déroute qu’implique le fait d’habiter un monde dont ni la provenance ni la destination ne sont plus données ?
On ne peut s’étonner davantage qu’un nombre croissant de fictions contemporaines (notamment hollywoodiennes) trouvent dans l’imaginaire de la fin du monde de quoi incarner la vision angoissante d’un devenir oscillant entre exténuations, crises et catastrophes successives. Mais on mesure aussi combien le motif de la destruction ultime, s’il offre à certains cinéastes l’occasion de ressaisir une part essentielle de notre expérience (Les Derniers Jours du monde, Melancholia…), reste pour d’autres, dès lors qu’ils s’en tiennent au scénario apocalyptique type (le combat pour la survie d’une poignée de rescapés – The Happening, The Road, The Day After Tomorow…), une façon de l‘éluder.
Le titre de ce numéro tente de l’indiquer : c’est à envisager les épuisements avec lesquels nous avons à faire dans leur multiplicité – et donc leur particularité et leur diversité –, qu’un peu d’histoire « à l’état pur » peut être saisi ; c’est en se tenant à la mesure de la singularité des événements, phénomènes, actes, sentiments, pensées, rêves et divagations propres à en témoigner, que le cinéma peut cerner ce qui, dans cette histoire même, nous échappe.
La question qui nous occupe ici pourrait donc s’énoncer ainsi : quelles fictions, récits, formes et mises en scène parviennent à restituer l’expérience à laquelle nous livrent les fins diverses et multiples dont nous sommes les contemporains, à donner à voir l’inconnu et l’inédit, l’ouverture salutaire ou les effrois et tristesses qu’elles produisent – autrement dit : à nous renseigner sur les manières diverses et variées dont nous en sommes à la fois les acteurs et les témoins.
La dernière partie de ce numéro sera consacrée à Mafrouza, d’Emmanuelle Demoris.
Chronique de la vie des habitants de Mafrouza, bidonville d’Alexandrie construit sur le site d’une nécropole gréco-romaine, ce film fleuve, composé de cinq parties, nous immerge progressivement dans le quotidien d’hommes et de femmes qui, livrés à la plus grande précarité, paraissent savoir mieux qu’ailleurs ce que vivre veut dire. La puissance des paroles et des récits, l’inventivité des chants et des gestes, les multiples bricolages qu’échafaude chacun pour tenir au milieu des décombres, l’énergie déployée pour résister à l’adversité, les ruses, tours et détours via lesquels les uns et les autres parviennent à s’arracher à la misère de la vie nue, composent ainsi la trame complexe d’un monde hors du commun.
Mais la force de Mafrouza dépend également de la démarche au long cours entreprise par la cinéaste, – démarche impliquant un tournage de plusieurs années et un ensemble de choix de réalisation aptes à bousculer les formes patentées du cinéma documentaire et à en questionner à nouveau les enjeux. En se donnant pour projet d’accueillir sans idées préconçues ni « question à traiter » l’expérience des habitants de Mafrouza, en exposant le processus qui la conduit à approcher telle ou telle personne et à trouver une place parmi ceux qu’elle ne connait pas, la cinéaste ouvre le champ d’une perception où vérité du tournage et réel représenté s’interpénètrent sans cesse, et deviennent la condition d’une rencontre possible avec l’autre.
Cet ensemble sera ainsi l’occasion de revenir largement, avec Emmanuelle Demoris, sur la genèse du film, les étapes de sa fabrication, ses moyens de production et l’ensemble des partis pris qui en ont configuré la réalisation.
Sorti en salles l’été dernier, Mafrouza fera l’objet d’une sortie DVD au printemps 2012 (Shellac éditions).