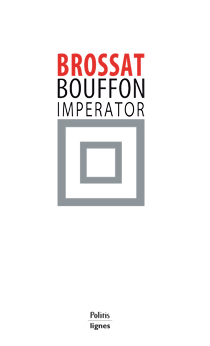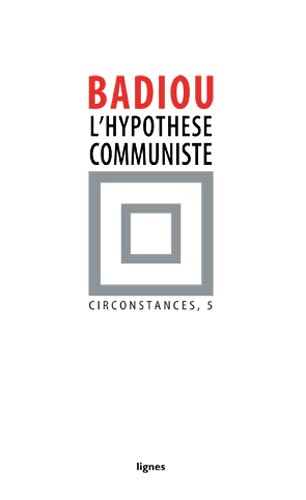Deux textes : l’un – « Tous Coupat, tous coupables » ; l’autre, « Le Moralisme anti-violence », remanié d’après le texte publié dans le n°29 de la revue Lignes (mai2009), consacré au thème de la « Violence en politique », ici réunis dans un court volume, vif, engagé, à la vérité tout à fait intempestif : ne visant rien moins qu’à affirmer que la politique ne saurait, sans hypocrisie, prétendre faire l’économie de la violence ; sans hypocrisie ni danger : tout ce qu’elle refoulera ainsi, ou qu’elle croira avoir ainsi conjuré lui sera rendu, retourné, qui sait de quelle façon et au bénéfice de qui ? La vérité veut d’ailleurs qu’on dise ceci : que n’est ainsi conjurée, stigmatisée qu’une seule sorte de violence, celle à laquelle sont tentés de recourir ceux à qui manque tout autre forme de recours (disons la violence de défense ou d’opposition) ; pas la violence policière de l’État ni la violence sociale de la domination économique. Elles ne s’en trouvent que d’avantage – définitivement ? – légitimées. Vif, engagé, intempestif, ce livre est drôle aussi, au moins autant que la situation le permet.
À propos de « l’affaire Tarnac » : « Ce qui est ici en question n’est évidemment pas la nécessité impérieuse que s’organise une solidarité sans faille avec les inculpés de Tarnac, et que celle-ci soit aussi puissante et déterminée que possible. La question est plutôt que cette solidarité s’est déployée sur une ligne de pente dont le propre est qu’elle ensevelit sous l’épaisse couche de cendres d’une police sentimentale et « démocratique » tout ce qui pouvait constituer le venin, le ferment de radicalité de L’Insurrection qui vient, avec son appel à se mettre « en route ». Le rassemblement informe et sans bords qui s’est constitué en faveur des inculpés (et dont, répétons-le, la volte-face des journaux a donné le signal et en quelque sorte défini les conditions) n’est pas sans rappeler le consensus anomique, propre à la « démocratie du public » brocardé par des auteurs comme Rancière et Badiou ; il s’étend maintenant jusqu’aux dirigeants du parti socialiste, voire du Modem et, inclut bien sûr, le télégénique Besancenot ; mais c’est un rassemblement qui se tient aux antipodes de ce que s’efforçait de présenter L’Insurrection qui vient et la décision d’y faire jouer en acte le motif de la communauté. »
À propos de la violence dans les sociétés démocratiques : « Nous n’en finissons pas de subir des injonctions d’avoir à nous prononcer contre toute forme de politique violente, et, plus généralement, contre la violence sous toutes ses formes. L’aversion du public contemporain à la violence vive est constamment soutenue par la promotion de normes immunitaires dont l’effet est de jeter le discrédit aussi bien sur toutes sortes de conduites coutumières dans nos sociétés (la bagarre du samedi soir, la fessée administrée à l’enfant turbulent, la main baladeuse dans le métro) que sur l’engagement physique dans les pratiques politiques (la manifestation virant à l’émeute, le pugilat au Parlement, la grève insurrectionnelle…). En même temps, ce mouvement général de pacification des mœurs nourrit le sentiment de l’insécurité, au point que, si nos sociétés n’ont jamais été aussi « sûres », elles n’en apparaissent pas moins aux yeux d’une partie au moins de la population comme de plus en plus dangereuses.
Au reste, la pacification, la délégitimation de la violence ont une lourde contrepartie : la concentration toujours plus dense des moyens de violence dans la sphère de l’État et de ce qui s’y agence : plus nos sociétés son “sûres” et plus elles sont policières et c’est au détriment des libertés publiques que prospère la criminalisation de toute espèce de violence – la récente affaire de Tarnac en est une illustration entre mille.
Au demeurant : “toute espèce de violence” est une expression bien expéditive. Ce dont il est en réalité question est une opération discursive de grand style autour de l’enjeu “violence”. Le mouvement de pacification de la vie sociale et du domaine politique a pour enjeu un formatage rigoureux des perceptions collectives de “la violence” et une réforme radicale du code destiné à séparer le violent du non-violent. En bref, il s’agit d’inculquer à la population la vision sécuritaire/policière de ces enjeux. À ces conditions, sera donc désignée comme violente l’émeute qui a embrasé une cité de banlieue suite à une “bavure” policière – pas cette action policière elle-même ; sera stigmatisée comme violente une occupation d’usine accompagnée de quelques saccages – pas le licenciement collectif qui l’a précédée ; sera désignée comme violente une attaque de banque – pas les escroqueries en grand commises par des prédateurs de haut vol comme Kerviel ou Madoff ; sera décrié comme violent un attentat suicide commis par un kamikaze islamique, pas les “opérations” aériennes de l’armée israélienne sur la bande de Gaza…
Dans ces conditions, “la violence” tend à devenir d’une manière exclusive le fait de l’autre – du pauvre, de l’immigré, de la plèbe mondiale, de l’islamiste, de l’État-voyou… Elle tend toujours davantage à faire l’objet de rites de détestation et d’exorcismes, à devenir une question morale plutôt que politique ou sociale. Son évocation péjorative devient un moyen de gouvernement des populations à la peur et à la sécurité, davantage qu’à la paix. Le monde des “pacificateurs” qui nous gouvernent est, comme chacun peut s’en assurer, tout sauf un monde en paix.
Surtout, la nouvelle police des discours qui “règle” la question de la violence constitue un formidable empêchement à penser et agencer une politique vive, déliée des dispositifs généraux de la démocratie-marché (Gilles Châtelet). Ce n’est pas seulement que les espaces publics se trouvent de plus en plus occupés par toutes sortes de dispositifs policiers, c’est aussi que l’appareil général de criminalisation de “la violence” tend à désarmer dès l’origine, à la racine, toute entreprise politique qui ne s’effectuerait pas aux conditions mêmes de la domination ou, si l’on veut, de la société de contrôle. Il s’avère à l’usage que le mouvement de “déviolentisation” de la politique qui s’est accéléré sans relâche depuis le début des années 1980, aboutit, en réalité, à annihiler toute énergie politique se déployant hors des espaces du programmable et du gouvernable.
Notre impuissance politique actuelle face à l’Etat-Sarkozy qui, pourtant, fait eau de toutes parts et n’est, substantiellement, qu’une bouffonnerie, tient, pour une bonne part, à cette extermination de tout possible politique radical par l’avènement de ce dispositif général anti-violence. »
Alain Brossat est professeur de philosophie à l’université de Paris-8 Saint-Denis. Il a récemment publié : Le Grand dégoût culturel (Anabet, 2008) ; Bouffon Imperator (Lignes, 2008). Il contribue très régulièrement à la revue Lignes.
Entretien d’Alain Brossat avec Jacques Munier, sur France Culture, À plus d’un titre).