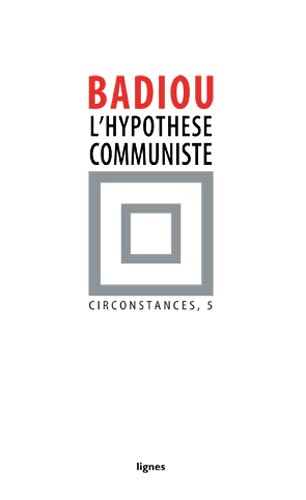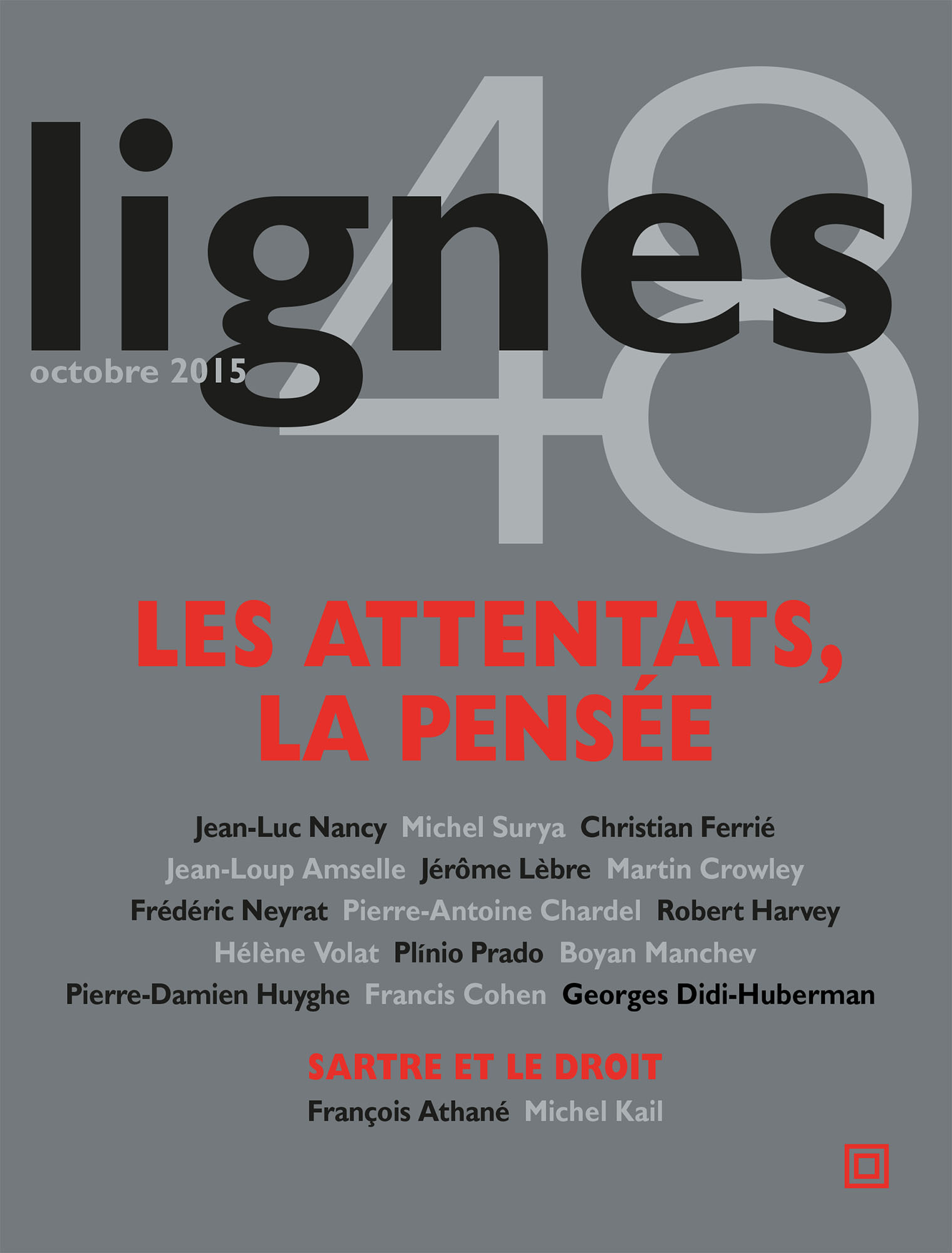Le mot « crise » en cache un autre – encore qu’à peine : le mot « violence ». La violence est sur toutes les lèvres. Comme une tentation ? Ce n’est pas impossible ; comme une inquiétude ? Ce n’est pas douteux. L’inquiétude est que de l’une résulte l’autre. La violence, la plupart la redoutent : le gouvernement, bien sûr ; les médias aussi qui sont toujours de tous les gouvernements ; une bonne partie de l’opinion enfin (selon qu’elle lui mesure ce qu’elle a à y perdre). Une autre partie la « comprend », du moins en comprendrait-elle la possibilité (c’est ce que les sondages lui font dire). Mais la tentation ? Une chose est sûre : personne n’en appelle plus à elle. Le mot, la chose ont été une fois pour toutes bannis. Du moins le sont-ils d’un monde sur lequel tout le monde s’accorde à très peu près – ne s’accorderaient-ils pas toutefois sur les moyens de répondre aux crises qu’il traverse (l’accuseraient-ils même d’aller de crise en crise). Il semble donc qu’aux yeux du plus grand nombre, si ce n’est de tous, la violence ne soit plus possible ni permise, ne serait-ce que parce qu’il ne saurait y avoir d’autre monde que celui-ci.
Ce qui veut dire encore : que la violence était possible, si ce n’est permise, aussi longtemps que l’hypothèse d’un autre monde, d’un monde alternatif, était elle-même possible et permettait qu’on la formât jusqu’à la violence. Cette violence qu’on disait révolutionnaire. Or il n’y a plus personne à se laisser tenter par la révolution au point de penser qu’elle doive en passer par la violence. Et si quelques-uns craignent que la situation soit pré-révolutionnaire, c’est qu’eux-mêmes vivent, pensent, sentent et dominent comme sous l’Ancien Régime. Joyeux jeu de dupes où prétendent redouter la violence de la révolution ceux qui seraient prêts à tous les moyens violents pour l’empêcher, quand ceux que la révolution tenterait encore doutent qu’elle doive « coûter » quelque violence que ce soit. Fin d’un cycle. Fin d’une histoire (sinon fin de l’histoire, ainsi qu’annoncée il y a 20 ans – mais pour cynique que fût cette annonce, elle touchait assez juste pour qu’on ne voie pas, vingt ans après, que rien la dés-annonce).
À moins que… À moins que ce que ce monde a à craindre lui soit moins extérieur qu’intérieur. À moins qu’on ait surestimé la logique qui est la sienne ; à moins que celui-ci ait plus à craindre d’elle que de n’importe quelle autre qui prétendrait s’y opposer. Autrement dit, la question est : et s’il n’y avait plus nul besoin qu’un autre monde soit possible pour que celui-ci ne le soit plus. Et si la violence naissait de lui et de lui seul sans que nul n’ait besoin d’en appeler à l’hypothèse d’aucun autre. Nul besoin donc de quelque principe d’adversité que ce soit, le système nourrissant sa propre adversité, une adversité vide, ou fantôme. Que la violence y survienne, et il ne pourra que s’en accuser lui-même. C’est le prix que lui en coûtera d’en appeler continûment, et sur tous les tons, à la démocratie avec laquelle c’est lui-même qui en a fini – mieux qu’aucun des autres systèmes qui ne l’aimaient certes pas davantage mais qui n’avaient pas su faire en sorte qu’elle ne restât pas au moins à l’état d’espérance. Il se pourrait bien que ce monde touche enfin au fond de son nihilisme constitutif. Si c’est le cas, une violence en résultera en effet. Une violence intérieure ou intrinsèque ; sans but ni fin ; le livrant à la violence qui est la sienne.
*
Il y a quelques mois, au moment où Lignes engagea ce numéro, la « crise » au sens récent où on l’emploie depuis n’était pas la règle encore. La question ne se posait donc pas alors de la possibilité des violences internes ou intrinsèques. Mais se posaient, comme appartenant encore à un monde dont on ne savait pas à quel point il allait vite devenir ancien, des questions sur les violences d’opposition, ou contre-violences (réelles ou fantasmés par le pouvoir d’État). L’affaire dite de Tarnac, puis bientôt du « Comité invisible » faisait la une. C’est de cette « affaire » que nous sommes partis, sans bien sûr vouloir nous y attarder plus qu’à un symptôme. En ces termes que nous reproduisons ici, ne serait-ce que pour qu’on comprenne comment lui répond une partie des textes qui suivent. Même si une autre partie s’est, chemin faisant, efforcée de ne pas séparer entre cette pensée que nous sollicitions alors et celle que l’accélération des événements appelait :
« De ladite affaire des “Insurrectionnels de Tarnac” – ou encore dudit “comité invisible” –, est-il possible de tirer quelques leçons déjà ? Ou, sinon des leçons, quelques questions ?
On a d’abord accusé la police et l’outrance de ses méthodes (des méthodes d’exception en effet) ; puis la justice et l’outrance de ses qualifications (“terrorisme” pour des faits pourtant aucunement avérés et qui, quand bien même l’auraient-ils été, n’en relèvent guère). On le pouvait, on y était justifié. En même temps qu’on n’eût pas dû s’en étonner outre mesure, et que cela n’eût pas dû suffire : après tout, l’État était dans son rôle – “terrorisme” est le mot par excellence auquel il doit de tenir le peu d’existence qui lui reste (on comprend dès lors qu’il l’invoque avec fébrilité) ; existence qu’il impartit à sa police d’incarner, et que celle-ci ne se contente pas d’incarner, qu’elle théâtralise avec zèle.
Tout était donc à peu près conforme. Tout l’était à ceci près cependant que la défense des inculpés s’est tout entière déclinée sur le principe de leur innocence. Avec raison : il est vraisemblable que ceux-ci sont innocents de ce dont on les accuse (les relaxes intervenues depuis en témoignent). Mais, s’ils ne l’avaient pas été ? S’ils ne l’avaient pas été, ce sont la plupart de ces défenses qui n’auraient pas tenu ; qui auraient si peu tenu que c’est le principe même de leur défense qui aurait semblé mis à mal. Pourquoi ? Question qui semble sous-entendre cette autre : parce qu’ils auraient, du coup, été indéfendables ?
La question n’est pas ici de cette affaire, sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir ; à partir de laquelle, au contraire, nous proposons de partir. Par exemple, en demandant : si d’autres s’étaient rendu réellement coupables des mêmes faits, auraient-ils été aussi sinon autant défendus et, cette fois, suivant quels mots d’ordre ? De cette question, deux autres dépendent que la logique impose : 1. que peut bien signifier d’en appeler au droit auprès d’un État qui s’en exempte aussi souvent que de besoin (principe dominant de la défense des inculpés opposée à l’action de l’État) ? 2. et qu’opposer à l’État en guise de défense des actions qui s’exceptent du droit ?
Cette dernière question est la plus ambiguë ; elle ne cherche pas en soi à les encourager, seulement à attirer l’attention sur le fait que la situation (économique, sociale, politique) est incontestablement faite pour que se multiplient les actions qui passent outre le droit (c’est le cas d’ailleurs, depuis un certain nombre d’années, d’actions, le plus souvent syndicales, dont le Parquet a invariablement “criminalisé” les auteurs). À s’en tenir au seul présupposé de l’innocence des auteurs de ces actions (syndicales ou politiques), on s’abstient de penser la possibilité d’actions dont les auteurs auraient eu des raisons – sinon raison – de se rendre coupables. On s’abstient a fortiori de se prononcer au sujet et de ces actions et de leurs auteurs. Car la question : qu’opposer à l’État en guise de défense des actions qui s’exceptent du droit ?, en nourrit une autre, qui en est proche : s’excepter du droit est-il par principe illégitime dans un système de représentation qui impartit et délivre la légitimité des pensées et des actions selon que celles-ci se soumettent strictement au droit.
Deux hypothèses sont ici en présence : ou le droit de l’État est contestable, ou l’État s’affranchit lui-même d’un droit qui ne l’est pas. Contester l’État, dès lors, c’est ou rappeler celui-ci au droit dont il se réclame ou réclamer de lui qu’il consente au droit qui naîtra de sa contestation. Dans un cas comme dans l’autre, la violence qu’il engage engage à une violence qui le conteste. »
Michel Surya
Sommaire
Michel Surya, Présentation
Alain Brossat, Le paradigme du lancer de chaussettes
Jacob Rogozinski,
Offensive de printemps en Sibérie occidentale
Frédéric Neyrat, Rupture de défense
Bernard Noël, Plutôt non que oui
Jean-Luc Nancy, Violente politique
Alain Naze, De la violence en milieu tempéré
Daniel Bensaïd, Une violence stratégiquement régulée
Laurent Margantin, Des mots dangereux,
ou que peut une parole insurrectionnelle ?
Mathilde Girard, Sabotages en quête d’auteur
Anselm Jappe, La violence, mais pour quoi faire ?
Pierandrea Amato, L’indécidable et la violence
Alain Jugnon, Des morts tueurs : un évêque est atteint
Sidi Mohammed Barkat, Octobre-novembre 2005
Les feux élémentaires
Mehdi Belhaj Kacem, L’architransgression
Dimitra Panopoulos, Le partisan de l’universel
Sophie Wahnich, Peuple et violence dans l’histoire
de la Révolution française
Épilogue, contrepoint
Jean-Christophe Bailly, De la fragilité des statuettes.
Pour une esthétique de la précaution
Textes réunis par Alain Brossat et Michel Surya